Chers lecteurs, chères lectrices, vous l’apprendrez bien assez tôt mais la science-fiction est mon genre littéraire de prédilection. Je l’ai découvert très jeune notamment grâce à au cinéma qui m’a poussée à m’intéresser aux supports écrits. C’est en prenant de l’âge (la vingtaine quoi) que j’ai découvert des grands noms de la SF comme : Asimov, Bradburry, K. Dick, Simack. Et grâce à eux, je me suis plongée dans l’Âge d’Or de la science-fiction.
L’Âge d’Or de la SF est une période extrêmement prolifique en terme de publications de science-fiction aux États-Unis. Elle s’étend, à peu près, de 1938 à 1946 et compte un très grand nombre de contributeurs, dont les auteurs cités plus haut. Cette période a surtout vu naître des récits de « Hard SF », c’est à dire des récits avec une histoire s’appuyant sur des éléments scientifiques exacts, basés sur des découvertes et savoirs modernes. C’est pour cette raison que bon nombre de publications de cette époque parlent d’énergie nucléaire, de voyage dans l’espace, de robots… puisqu’elles s’inspiraient des recherches scientifiques et technologiques de l’époque.
Et c’est ce que je recherche dans la science-fiction : une histoire basée sur des connaissances scientifiques précises, avec la touche d’imagination nécessaire pour faire voyager l’humanité dans l’espace, découvrir de nouvelles planètes et de nouvelles formes de vie.
Le roman qui nous intéresse aujourd’hui : Dans la Toile du Temps coche tous ces critères, avec en plus un style qui a su me séduire dès les premières pages.
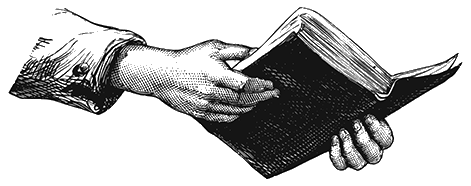
Dans la Toile du Temps est un space opera – un sous-genre de la science-fiction qui met l’accent sur les voyages spatiaux et les guerres galactiques, le tout saupoudré d’une touche de mélodramatique et d’aventures – qui s’étend sur des millénaires.
Dans le récit d’Adrian Tchaikovsky, la planète Terre a été complètement bousillée par l’Homme, et dans une tentative désespérée de perpétuer l’espèce humaine, plusieurs grandes arches, contenant toutes des centaines d’humains endormis, ont été envoyées dans l’espace à la recherche d’un nouvel habitat pour l’humanité.
De toutes ces arches, nous suivons le Gilgamesh qui après plus de deux mille ans de voyage spatial découvre une planète foisonnante de végétation et en tout point semblable à la Terre avec de l’oxygène, une gravité équivalente et de l’eau.
Seulement, cette planète est gardée par un satellite étrange. La ruine ancestrale d’une civilisation humaine alors disparue : l’Ancien Empire.
Au cours de la lecture nous comprenons que les humains stockés dans le Gilgamesh sont les descendants des Hommes qui ont détruit la planète (concrètement nous) et qui ont appartenu à cet Ancien Empire. Un Empire hautement évolué technologiquement et qui voyageait dans l’univers les doigts dans le nez. Avec les nombreuses guerres et la destruction progressive de la planète cette humanité s’est auto-détruite, perdant de sa superbe et notamment ses connaissances qui ont fini par se dégrader. Laissant ainsi à sa descendance une planète invivable et une technologie obsolète.
Cette idée de régression technologique, nous la retrouvons notamment chez Asimov et son célèbre Cycle de Fondation. Une notion que je trouve particulièrement intéressante et qui est bien traitée chez Tchaikovsky.
Mais pourquoi un satellite humain garderait-il une planète si éloignée du système solaire ? Que peut-elle bien cacher ? C’est ce que vont s’évertuer à découvrir les habitants du Gilgamesh.
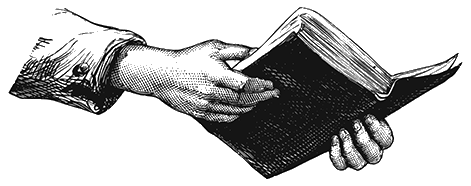
Sans trop vous en dévoiler, parce que le but de cette chronique est quand même de vous donner envie de lire Dans la Toile du Temps, tous les deux chapitres nous passons du point de vue du Gilgamesh (plus précisément de Holsten, un linguiste spécialiste du langage de l’Ancien Empire) au point de vue des êtres peuplant la planète verdoyante. Une narration intéressante puisqu’elle permet de voir l’univers du roman de deux angles complètement différents, apportant des réflexions fascinantes et de la profondeur au récit.
A cela vient s’ajouter le questionnement propre à de nombreuses publications de science-fiction : la place de l’humanité dans l’espace, son impact sur les environnements qu’elle quitte, qu’elle découvre et sur les différentes nouvelles formes de vie qu’elle rencontre. Ce qui est intéressant dans cette lecture en particulier, c’est l’obstination de l’Homme à vouloir s’octroyer un territoire déjà peuplé, se l’accaparer quitte à accomplir le génocide d’une forme de vie innocente (alors que cette erreur a été répétée à maintes reprises dans le passé et a conduit à la perte du berceau de l’espère humaine : la planète Terre).
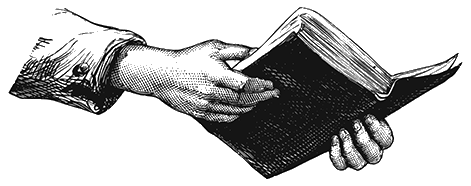
Je salue l’auteur pour son travail de recherche scientifique incroyable (parce qu’il y a un gros étalage de connaissances dans ce roman, pour mon plus grand plaisir). De la Hard SF pure et dure. Grâce à ses études en psychologie et en zoologie, Tchaikovsky crée un univers ultra détaillé et cohérent. Il écrit ici une véritable épopée qui traverse les siècles, pour nous montrer l’évolution du Gilgamesh avec ses rébellions, la folie qui touche l’équipage et le désespoir de trouver une planète viable. Mais aussi l’évolution de la terre convoitée et ses habitants. Une histoire extrêmement intéressante et prenante que je recommande à tous les fans de SF.
Laisser un commentaire